
Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir une histoire captivante que chacun devrait lire au moins une fois dans sa vie. Il s’agit de la nouvelle intitulée « Maison occupé », ou « Casa Tomada » en espagnol, écrite par Julio Cortázar, un écrivain argentin dont la vie a été dédiée à l’art de l’écriture. Publiée dans la revue « Los Anales de Buenos Aires », cette nouvelle a suscité des milliers d’analyses, qu’elles soient politiques, sociales ou psychologiques, sans jamais parvenir à un consensus sur sa signification. Ce qui est indéniable, c’est que cette histoire pousse les lecteurs à réfléchir, en remettant en question l’idée que tout a une explication claire et définitive.
Interrogé sur cette œuvre controversée, Cortázar a révélé qu’elle était née d’un rêve qu’il avait fait. Il a également partagé son plaisir à lire les différentes interprétations de son récit, car elles lui permettaient de découvrir des aspects auxquels il n’avait pas pensé lui-même.
Bien que cette histoire ne propose pas une explication spécifique, elle mérite d’être lue car elle reflète beaucoup de notre réalité.
Elle évoque souvent ce sentiment d’être pris au piège dans une « Maison occupé « , où l’on se sent étouffé et limité.
Prenez quelques instants pour vous plonger dans cette histoire, puis partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Maison occupé – Julio Cortázar
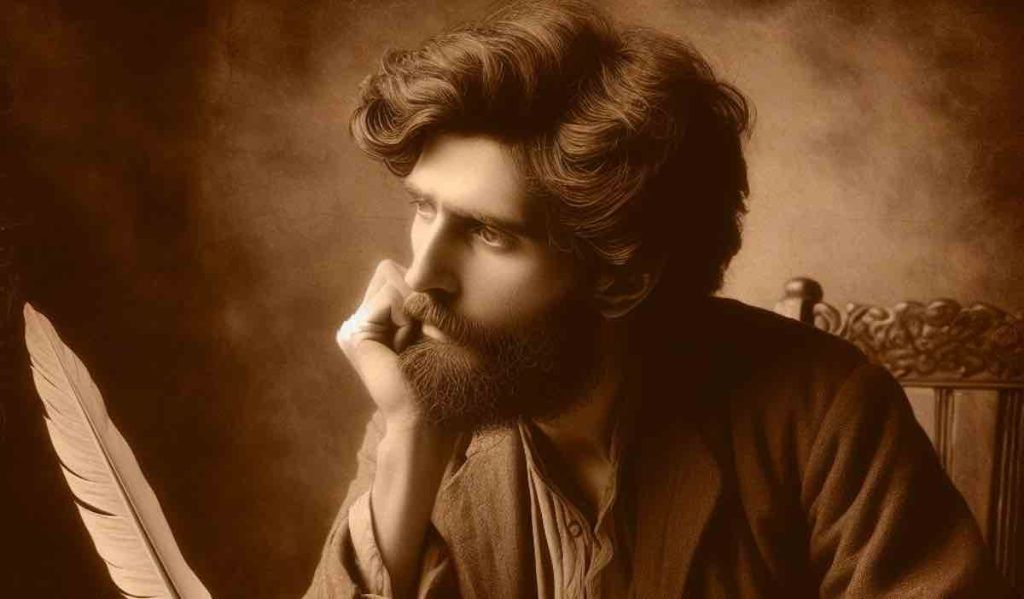
La maison nous plaisait beaucoup, car en plus d’être spacieuse et ancienne (les vieilles demeures succombent aujourd’hui aux ventes lucratives de leurs matériaux), elle renfermait des souvenirs de nos arrière-grands-parents, de notre grand-père paternel, de nos parents et de toute notre enfance.
Irène et moi avions pris l’habitude d’y rester seules, ce qui était étrange, car huit personnes pouvaient y vivre sans se gêner. Nous faisions le ménage le matin, nous nous levions à sept heures et, vers onze heures, je laissais à Irène les dernières pièces à visiter et je me dirigeais vers la cuisine. Le déjeuner était à midi, toujours ponctuel ; une fois les derniers plats lavés, il ne restait plus rien à faire. Nous aimions déjeuner en contemplant la profondeur et le silence de la maison, ainsi que la propreté que nous avions réussi à maintenir.
Parfois, nous pensions même que c’était la maison elle-même qui nous empêchait de nous marier. Irène avait renvoyé deux prétendants sans raison particulière, j’avais perdu Maria Esther peu avant nos fiançailles. Nous sommes entrées dans la quarantaine avec l’idée que notre mariage simple et silencieux de sœurs était une conclusion nécessaire à la généalogie établie par nos arrière-grands-parents dans notre maison.
Nous y mourrions un jour, tandis que des cousins paresseux et grossiers garderaient la maison et la feraient démolir pour s’enrichir de la terre et des briques ; ou bien, nous la démolirions nous-mêmes, avec raison, avant qu’il ne soit trop tard.
Irène était une jeune femme née pour ne déranger personne.

En dehors de ses activités matinales, elle passait le reste de la journée à tricoter sur le canapé de sa chambre. Je ne sais pas pourquoi elle tricotait autant ; je pense que les femmes tricotent lorsqu’elles considèrent cette tâche comme une excuse pour ne rien faire. Irène n’était pas comme ça, elle tricotait des choses qui étaient toujours nécessaires : des manteaux pour l’hiver, des chaussettes pour moi, des châles et des gilets pour elle. Parfois, elle tricotait un gilet et le défaisait immédiatement parce que quelque chose ne lui plaisait pas ; c’était drôle de voir ce tas de laine crépue dans le panier, résistant à la perte de sa forme précédente.
Le samedi, j’allais en ville pour acheter de la laine ; Irène faisait confiance à mon bon goût, elle appréciait les couleurs et je n’ai jamais eu à rapporter les mèches. Je profitais de ces sorties pour flâner dans les librairies et demander en vain s’il y avait quelque chose de nouveau dans la littérature française. Depuis 1939, rien de précieux n’était arrivé en Argentine. Mais c’est de la maison dont je veux parler, de la maison et d’Irène, car je n’ai aucune importance. Je me demande ce qu’Irène aurait fait sans le tricot. On peut relire un livre, mais lorsqu’un manteau est terminé, on ne peut le répéter sans scandale.
Un jour, j’ai trouvé dans le tiroir d’une commode des châles blancs, verts et lilas couverts de boules à naphtaline, empilés comme dans une mercerie ; je n’ai pas eu le courage de lui demander ce qu’elle comptait en faire. Nous n’avions pas besoin de gagner notre vie, chaque mois l’argent arrivait des champs et il augmentait toujours. Mais seul le tricot distrairait Irène ; elle faisait preuve d’une dextérité merveilleuse et je passais des heures à regarder ses mains comme des chattes d’argent, les aiguilles qui allaient et venaient, et un ou deux petits paniers par terre où les boules tremblaient constamment. C’était très beau.
Comment puis-je oublier la répartition de la maison !

La salle à manger, un salon avec des tapisseries, la bibliothèque et trois grandes chambres étaient situées dans la partie la plus éloignée, celle donnant sur la rue Rodríguez Pena. Seul un couloir avec sa porte massive en acajou isolait cette partie de l’aile avant où se trouvaient une salle de bain, la cuisine, nos chambres et le hall central, auquel communiquaient les chambres et le couloir. On entrait dans la maison par un couloir en tuiles majorquines et le portail se trouvait à l’entrée du salon.
Ainsi, les visiteurs entraient par le couloir, ouvraient le portail et pénétraient dans le hall ; là, ils trouvaient les portes de nos chambres de chaque côté et, en face, le couloir menant à la partie la plus éloignée ; en longeant ce couloir, on passait la porte en acajou et un peu plus loin commençait l’autre côté de la maison. On pouvait également tourner à gauche juste avant la porte et suivre le couloir plus étroit menant à la cuisine et à la salle de bain.
Lorsque la porte était ouverte, les visiteurs remarquaient à quel point la maison était grande ; autrement, elle donnait l’impression d’être un appartement en cours de construction, à peine habitable ; Irène et moi vivions toujours dans cette partie de la maison, nous ne dépassions presque jamais la porte en acajou, sauf pour faire le ménage, car la poussière s’accumulait rapidement sur les meubles.
Buenos Aires pouvait être une ville propre, mais c’était grâce à ses habitants et à rien d’autre. Il y avait trop de poussière dans l’air ; à peine une brise soufflait et déjà on sentait la poussière sur les marbres des consoles et entre les losanges des nappes en macramé ; il fallait beaucoup de travail pour l’enlever avec un plumeau, il volait et restait suspendu dans l’air un instant avant de retomber sur les meubles et les pianos.
Je m’en souviendrai toujours clairement, car c’était très simple et sans circonstances inutiles. Irène tricotait dans sa chambre, vers huit heures du soir, et soudain j’ai eu l’idée de mettre la bouilloire en marche pour le chimarrão. J’ai parcouru le couloir jusqu’à me trouver devant la porte entrouverte en acajou, et je tournais le coin qui menait à la cuisine lorsque j’ai entendu quelque chose dans la salle à manger ou dans la bibliothèque. Le son était vague et sourd, comme celui d’une chaise tombant sur le tapis ou d’un murmure étouffé d’une conversation. Je l’ai entendu aussi, au même moment ou une seconde plus tard, au bout du couloir qui menait de ces pièces à la porte. Je me suis précipité vers le mur avant qu’il ne soit trop tard, j’ai refermé la porte d’un seul coup, en soutenant mon corps ; Heureusement, la clé était de notre côté et j’ai également passé la grande serrure pour plus de sécurité.
Je suis retourné dans la cuisine, ai fait chauffer la bouilloire et, quand je suis revenu avec le plateau à maté, j’ai dit à Irène :
— J’ai dû fermer la porte du couloir. Ils ont pris une partie des fonds.
Elle a laissé tomber son tricot et m’a regardé avec ses yeux sérieux et fatigués.
- Es-tu sûr ?
- Absolument.
— Alors — dit-elle en reprenant les aiguilles — nous devrons vivre de ce côté.
J’ai préparé le chimarrão avec beaucoup de soin, mais il lui a fallu un moment pour reprendre sa tâche. Je me souviens qu’elle tricotait un gilet gris ; J’ai aimé ce gilet.
Les premiers jours nous ont semblé pénibles, car nous avions tous les deux laissé derrière nous beaucoup de choses qui nous plaisaient. Mes livres de littérature française, par exemple, étaient tous dans la bibliothèque. Irène pensait à une bouteille d’hespéridine vieille de plusieurs années. Souvent (mais cela n’arrivait que les premiers jours), nous fermions le tiroir d’une commode et nous regardions avec tristesse.
- Il n’est pas là.
Et c’était encore une chose que nous avions perdue de l’autre côté de la maison.
Cependant, nous avions également certains avantages. Le ménage est devenu tellement plus facile que, même si nous nous levions beaucoup plus tard, à neuf heures et demie par exemple, avant onze heures nous étions déjà les bras croisés. Irène a pris l’habitude de m’accompagner en cuisine pour m’aider à préparer le déjeuner. Après mûre réflexion, nous avons décidé ceci : pendant que je préparais le déjeuner, Irène nous préparerait les plats que nous mangerions froids le soir. Nous étions contents, car il était toujours inconfortable de devoir quitter les chambres l’après-midi pour cuisiner. Il ne restait plus qu’à mettre la table dans la chambre d’Irène et les plats froids.
Irène était contente car elle avait plus de temps pour tricoter.

J’étais un peu perdue à cause des livres, mais, pour ne pas contrarier ma sœur, j’ai décidé de revoir la collection de timbres de mon père, et cela m’a permis de gagner du temps. Nous nous sommes bien amusés, chacun avec nos affaires, presque toujours ensemble dans la chambre d’Irène, qui était la plus confortable. Parfois, Irène disait :
— Regarde ce point que je viens d’inventer. Ça ressemble à un dessin de trèfle, n’est-ce pas ?
Un instant plus tard, c’est moi qui ai placé un petit carré de papier devant ses yeux pour qu’il puisse voir le mérite de certains sceaux d’Eupen et de Malmédy. Nous allions très bien et petit à petit, nous avons commencé à ne plus réfléchir. On peut vivre sans réfléchir.
(Quand Irène rêvait à voix haute, je perdais le sommeil. Je n’ai jamais pu m’habituer à cette voix de statue ou de perroquet, une voix qui vient du rêve et non de la gorge. Irène disait que mes rêves consistaient en de grands soubresauts qui me faisaient parfois tomber la couverture par terre. Nos chambres avaient le salon au milieu, mais la nuit, on entendait quelque chose dans la maison. On entendait notre respiration, notre toux, on sentait les gestes qui rapprochaient notre main de l’interrupteur de la lampe, l’insomnie mutuelle et fréquente.
A part ça, tout était calme dans la maison. Pendant la journée, il y avait des rumeurs domestiques, des bruissements métalliques des aiguilles à tricoter, des craquements au fur et à mesure que défilaient les pages de l’album philatélique. La porte en acajou, je crois l’avoir déjà dit, était massive. Dans la cuisine et la salle de bain, qui étaient près du mur, nous parlions plus fort ou Irène chantait des berceuses. Dans une cuisine, il y a suffisamment de bruit provenant de la vaisselle et du verre pour que d’autres sons y éclatent. Le silence était rarement permis, mais lorsque nous retournions dans les chambres et le salon, la maison était calme et peu éclairée, nous marchions même lentement pour ne pas nous déranger. Je pense que c’est pour cela que, la nuit, quand Irène commençait à rêver à voix haute, je devenais immédiatement insomniaque.)
C’est comme répéter la même chose, mais sans les conséquences.
Ce soir-là, j’avais soif et avant de me coucher, j’ai dit à Irène que j’allais à la cuisine chercher un verre d’eau. Depuis la porte de sa chambre (elle tricotait), j’entendais du bruit dans la cuisine ou peut-être dans la salle de bain, car la courbe du couloir atténuait le son. L’attention d’Irène fut attirée par mon arrêt brusque et elle vint à mes côtés sans rien dire. Nous écoutions les bruits, sentant clairement qu’ils provenaient de ce côté de la porte en acajou, dans la cuisine et la salle de bain, ou dans le couloir où commençait la courbe, presque à côté de nous.
Sans même nous regarder, j’ai serré le bras d’Irène et je l’ai entraînée avec moi jusqu’au portail, sans me retourner. Les bruits devenaient de plus en plus forts, mais sourds, dans notre dos. J’ai claqué le portail et nous nous sommes retrouvés dans le couloir. À présent, le silence régnait.
— Ils ont pris le dessus, dit Irène. Son tricot pendait de ses mains et les fils atteignaient le portail, se perdant sous la porte. Quand elle réalisa que les pelotes étaient de l’autre côté, elle lâcha le tricot sans le regarder.
— As-tu réussi à récupérer quelque chose ? lui demandai-je inutilement.
- Non, rien.
Nous n’avions que les vêtements sur le dos.
Je me suis souvenu des quinze mille pesos dans le placard de la chambre. Mais il était désormais trop tard.
Avec ma montre-bracelet encore à mon poignet, j’ai constaté qu’il était onze heures du soir. J’ai entouré la taille d’Irène de mon bras (je pense qu’elle pleurait) et nous avons quitté la maison pour nous retrouver dans la rue. Avant de partir, j’ai ressenti un pincement de regret ; j’ai fermé soigneusement la porte d’entrée et j’ai jeté la clé dans l’égout du trottoir. Si jamais un pauvre diable avait eu l’idée de voler et d’entrer par effraction dans la maison, ce ne serait pas maintenant et avec la maison prise.
Quelle est votre interprétation du texte ? Laissez un commentaire ci-dessous !

